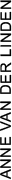Anartiste - "Problèmes d'intérieur..." - d. Kelvin
Interhumanité et continuitéIl est toujours délicat de débuter un texte consacré à l’œuvre d’un(e) artiste qu’on aime par des citations. Souvent palliatif (dans son acception originale, c'est-à-dire "dissimuler") de sa propre incapacité à écrire, mais parfois acte d'humilité : refuser de paraphraser autrui et s'effacer devant la perfection d'une formulation. C'est, j'espère et crois pouvoir l'affirmer, ici le cas.
Ces citations me paraissent en effet jeter une lumière crue (tout au moins crédible) pas tant sur l'œuvre d'Anne Van der Linden, dont aucune interprétation ne peut se prévaloir d'une qualité de vérité, que sur ce qui m'a enchaîné à la fois intellectuellement et affectivement à cette œuvre. Elles sont tirées de "L'érotisme", de Georges Bataille.
"A la base il y a des passages du continu au discontinu ou du discontinu au continu. Nous sommes des êtres discontinus, individus mourant isolément dans une aventure inintelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue"
"Toute la mise en œuvre de l'érotisme a pour fin d'atteindre l'être au plus intime, au point où le cœur manque. […] Toute la mise en œuvre érotique a pour principe une destruction de la structure de l'être fermé qu'est à l'état normal un partenaire du jeu".
"L'action décisive est la mise à nu. La nudité s'oppose à l'état fermé, c'est à dire à l'état d'existence discontinue. C'est un état de communication qui révèle la quête d'une continuité possible de l'être au delà du repli sur soi. Les corps s'ouvrent à la continuité par ces conduits secrets qui nous donnent le sentiment de l'obscénité. L'obscénité signifie le trouble qui dérange un état des corps conforme à la possession de soi, à la possession de l'individualité durable et affirmée".
Après avoir retapé ces phrases splendides, j'ai envie de clore là tant tout ajout de ma part me paraît devoir être, au mieux superfétatoire, au pire dérisoire. En effet, elles englobent l'ensemble des caractères singuliers, idiosyncrasiques même, des visions peintes ou dessinées par Anne Van Der Linden. Ces corps percés, éventrés, creusés, ces corps dont productions et déjections servent de passerelles entre émonctoires, entre émonctoires et sexes, entre émonctoires et bouches, entre bouches et sexes, entre ces orifices libérateurs qui en quelque sorte rompent la citadelle de peau dans laquelle nous sommes ontologiquement cloîtrés. La question demeure de savoir s'il s'agit bien encore d'érotisme. Car pour Bataille, cette quête éperdue de la continuité conduit à un érotisme de nature (même si contre-nature) romantique, qui fleure bon le début du XIXème siècle et son héros emblématique, le jeune Werther, qui boirait sa Charlotte à sa source méatique, la mangerait à son séant culier, et se baignerait dans ses lacs menstruels, plus qu'à ce triste et morne agencement fonctionnel d'intérieurs domestiques (je parle des lieux où se déroulent les scènes, pas des corps eux-mêmes), agencement qui souvent d'ailleurs, caractérise les scènes scatologiques dans les vidéos X, comme s'il fallait, par redondance visuelle, mettre en harmonie la "vulgarité" des actes avec celle du décor et de ses protagonistes. Bataille continue effectivement ainsi : "Il y a […] dépossession dans le jeu des organes qui s'écoulent dans le renouveau de la fusion, semblable au va-et-vient des vagues qui se pénètrent et se perdent l'une dans l'autre". Cette belle image maritime (le ressac dont les liquides corporels seraient l'océan et nos orifices les cryptes qu'ils viennent inonder), même si elle précède un long développement sur Sade, appartient encore à l'univers de la passion, alors que chez Anne Van der Linden, si amour il y a, il paraît noyé dans des rapports sans affect, sans tendresse, sans parler même de passion. L'extrême auquel aspire Bataille afin "de se perdre l'un dans l'autre" est ici remplacé par ce qui ressemble à la curiosité de se retrouver dans l'autre, à un acte narcissique visant à la seule satisfaction de son propre fantasme au prix d'objectiser l'autre dont le corps n'a plus, grâce au truchement de sa représentation graphique, les intangibles physiologiques qui sans cela le tueraient. Alors il devient possible de montrer la fantasmagorie mentale en ce qu'elle a de clinique , en témoignent d'ailleurs ces récurrents procès de meurtriers en série qui illustrent comme l'être qui a échappé au conditionnement empathique effectue avec une froideur méthodique la mise en œuvre de son fantasme (fétichiste en cela que l'autre n'est alors plus qu'objet transitionnel, comme le sont les corps meurtris qui peuplent les toiles d'Anne Van der Linden). Cette continuité entre les corps, cette transhumance trans-humaine, mais pas uniquement puisque les animaux (chats, chiens et singes) sont aussi convoqués, grégarité ultime où les espèces, comme en une grande parousie de chair et de sang, se mêlent et s’emmêlent les uns aux autres par le truchement serpentins de leurs viscères (jusqu’à cette femme à qui les boyaux de l’être aimé une fois mort, servent d’ultimes liens), est à mes yeux la grande affaire de cette œuvre.
Les animaux. Ces chiens au museau irrépressiblement attirés par les vulves des femmes, qui collent leur truffe humide de canin sur l’humaine moiteur des désirs féminins. Parfois elles les allaitent (« Allaitement » p.14). Les hommes eux sont des petits singes insignifiants qui grimpent aux femmes comme on escalade des montagnes, juste représentation de ce que toujours sera la femme pour le petit esprit gauche d’un homme, que sa comptable passion pour le rationnel conduit à penser qu’on l’humilie en la souillant alors qu’on n’en entame en rien l’irréductible mystère. Dans cette ménagerie humaine, les Hommes que cherchaient Diogène sont les femmes qui, même dépeceuses, chieuses, assassines, échappent à l’animalité.
L'une des visions la plus métaphoriquement lisible de cette continuité trans-humaine, est celle de cette femme dont le sexe est relié au cul d'un homme par un train, gares humaines, gode-ceinture à enfoncer dans l’arrière-train destinataire, sodomie du mâle qui requiert prothèse pour que la femelle puisse la perpétuer. Et puis surtout celle de l’enfant, cordon clampé puis tranché, premier geste d’accueil, bizutage prophylactique de ceux qui sont arrivés avant (pourquoi les autres mammifères n’ont-ils nul besoin de cet attirail contondant et de cette castration ombilicale à la naissance ?). Pas d’inhumanité donc, mais une interhumanité. Iconographie non pas des corps dépecés et des chairs déchiquetées, mais de la continuité entre les corps et les chairs. L’apparente frénésie de séparer n’est qu’impulsivité réversible. Car on coud chez Anne Van der Linden, on raccommode les têtes les unes aux autres (« Couture » p.12). On ne soigne pas certes, on tente de raccommoder les morceaux (comme on le dit d’un couple qui se déchire au seuil d’une séparation annoncée), avant d’accommoder nos restes. Une peinture ni pansée, ni pensée. Une mise à crue.
Mon intérieur, cet incontinu
A cette recherche nostalgique d’une continuité perdue qui, vue par Bataille, est celle d'un corps à l'autre, on peut opposer (ou plutôt apposer) celle de l’esprit au corps. Car en définitive, si la première est ontologique, liée à la condition humaine, la seconde est héritée d'une représentation du monde, au sens Schopenhauerien du terme ("Le monde est ma représentation") issue de siècles d'instillation et de transmission d'une vision dichotomique de l'être qui sépare le céphalique du corporel. La raison est céphalique, et l'amour qui fut un temps corporel puisque situé dans le cœur, a sous l'influence de la neurobiologie quitté la cage thoracique pour rejoindre la cage céphalique, mais une cage est une cage et on attend encore qu’on l’en libère. Cette dissociation presque schizophrénique, qui morcelle notre être en un corps-objet (« cet obscur objet du désir ») et une tête-sujet (et souvent assujettie aux désirs d'un corps pourtant supposé inhabité, comme si cet objet était alors "possédé") offre une vaste gamme d'angoisses et de tourments, puisque nous impose de cohabiter avec une masse de viscères et de déchets que nous ne considérons pas entièrement comme "nous", même si, par métonymie, nous l'utilisons sous l'intitulé générique du "je". Même si cela ne représente qu'une faible partie de ses visions (l'interhumanité est en effet majoritaire), Anne Van der Linden est tout de même la peintre d'une certaine réappropriation de la continuité entre ces deux cages (céphaliques et corporelles) ce qui, sans rendre la liberté, augmente la surface de captivité et surtout, ôte une source de terreur ; il est déjà bien suffisamment douloureux que les autres nous soient impénétrables, sauf à en forcer le passage à l'aide de nos sexes, de nos doigts, de nos langues, de nos regards, de nos mots ou alors d'objets tranchants, pour que l'architecture de chair, sa charpente squelettique et son mur de peau, ne représentent pas en plus une présence étrangère, une menace, amas d'organes aussi peu lisibles qu'une boîte noire dont la clé serait égarée. Alors on s'en débrouille comme on peut de ce corps, on s'ouvre le cul (« Le tordu » p.67) pour l'aider à s'exonérer, ou on se dépiaute pour mettre à nu sa viande et se débarrasser définitivement de la récurrente pilosité que les mâles répugnent à voir naître sur les jambes des femmes (« Epilation totale » p.57).
Ne jamais oublier que l’Homme est un animal troué a écrit je ne sais plus qui. L’homme surtout. Son cul semble lui être étranger. Il est fasciné par celui de la femme mais le sien le dégoûte plutôt. Assimilé à l’érogenèse du « pédé », il le sanctuarise, le réserve à la défécation. Les femmes, qui s’y trouvent confrontées dès les premières heures de maternité, semblent en revanche, chez Anne Van der Linden, beaucoup s’y intéresser à cet anus masculin. Mais elles s’en amusent (comme « Mab » p.65 qui enfonce avec une certaine malice son doigt dans celui de son petit homme, endormi sur ses genoux) ou tentent d’en trouver l’usage comme, dans « Le gonflable p.13», où elle l’utilise comme l’orifice d’un ballon, afin de le déployer telle une poupée gonflable. Le cul des hommes n’est pas tant pour la femme le pertuis d’un boyau excrémentiel qu’un conduit aérien qui s’offre à leur curiosité.
A l’intérieur… la merde génitrice
S’il y a une longue tradition scatologique masculine dans l'histoire des arts et apparentés, il s'agit la plupart du temps d'une persistance de l'abord infantile qui évoque l'interdit, le sale (instauré arbitrairement par les détenteurs du pouvoir de représentation qu'ils imposent aux enfants) afin de s'emparer d'un autre pouvoir : celui de rire de sa propre audace, de s'accorder la maîtrise d'un plaisir que ne peuvent connaître les maîtres qui n'ont pas matière à rire. Toute profondeur est escamotée pour n'en faire surnager que la supposée drôlerie transgressive. Les femmes ont avec la merde une relation souvent plus complexe. L'expulsion de l'étron au terme de sa putréfaction n'est pas sans évoquer celle du fœtus parvenu à maturation, tous deux issus des entrailles, l'un qui serait l'antithèse (j'allais dire l'antidote) absolue du désir masculin, l'autre son aboutissement (ensemencement, fertilisation, gestation, partition), la femme devenant alors une fée opérant la soudaine transmutation du mâle qui « prend » son plaisir en père à qui l'on « donne » un enfant. Chez Anne Van der Linden, l'interférence symbolique "défécation-enfantement" est permanente, les enfants sortant souvent du cul de leur mère et ressemblant parfois d'assez près à des étrons (ou alors emmitouflés dedans) à peine dotés des caractéristiques minimales pour être classés parmi les humains, chimères hybrides grasses et moulées comme une stéatorrhée (et sortant parfois un tambourin à la main, histoire de se faire entendre p.20). Dans l'un de ses dessins, d'une vulve céleste s'extrait un nouveau-né, qui a tout du poussah, et dont le méconium est un étron démesuré dont l'extrémité se révèle la fumée qui s'élève d'un voilier. Parabole poétique assez rare chez ce peintre qui paraît toujours vouloir refuser délibérément que son œuvre puisse être taxée de poétique (mais Apollinaire était à la fois un immense poète et un porno-scatologue indéniable). Souvent vient le sentiment qu'elle devrait se laisser désormais porter par cette maturité qui lui permettrait de sublimer des images qui semblent n'attendre qu'un abandon d'inutiles préjugés pour y accéder. Parfois, élargissant encore le champ symbolique (« La chieuse » p.23), l'héroïne défèque sur le toit de sa maison, ce foyer (home sweet homme) comme pour dire à ceux qui veulent la cantonner dans son rôle de femme au foyer "je vous emmerde, je vous conchie". Conchier évoque la rencontre inconcevable de deux orifices féminins investis de symboles en tout point opposés : la production du con et celle du cul. Elle ose ainsi la transgression du tabou symbolique ultime : se faire déféquer dans le vagin, qui plus est par un homme (« La chiotte »). Ce heurt entre un lieu aussi chargé de respect, du fait de sa fonction de perpétuation de l'espèce (même si par une sorte de corollaire inhérent à cette sanctuarisation, le viol est un fantasme particulièrement prégnant chez les hommes), et un autre tenu dans un dégoût universel (et, autre corollaire apparemment paradoxal, tout aussi source de fantasme, sodomiser une femme paraissant pour beaucoup d’hommes, comme la suprême récompense qu'elle puisse leur offrir), revêt un caractère réellement limite pour l'entendement, d'autant plus qu'il s'accompagne d'une mise en péril réelle de sa capacité de reproduction (le risque d'infection génitale est réel).
Cruauté ?
On ne saurait évoquer la cruauté chez Anne Van der Linden sans citer Bosch ou Goya. Certaines scènes chez l'une (« Les Barbecues ») renvoient à l'évidence à d'autres scènes chez les autres (« L’enfer » et « Les cannibales »). Même absence de dramatisation dans la description de ces agapes de viande humaine, la tranquille horreur qui perd même ses attributs horrifiques qui la rendent « acceptable » (car nous sommes physiologiquement programmés à voir associé à ce que nous trouvons horrible un ensemble de signaux qui provoquent une panique issue de réponses hormonales, alors que le paisible associé à l’horreur créé une sidération, une fascination, qui traumatise). Cependant, l’ambiguïté sur le sens à donner aux visions « cruelles » est considérablement plus puissante chez Anne Van der Linden, et le regard ne se lasse pas de scruter (en vain) une sémantique à ce qui n’en réclame pas, à ce qui se comprend avec des zones affectives auxquelles le néo-cortex n’a pas accès, comme tout ce qui se ressent de plus intense dans l’existence (attachement, passion, désespoir).
Pour conclure, j'aimerais citer (encore), Marcel Proust cette fois. Dans "Le temps retrouvé" il formule cette idée, qui fut émise il est vrai par bien d'autres que lui, et notamment des artistes "[…] nous ne sommes nullement libres devant l'œuvre d'art, […] nous ne la faisons pas à notre gré, mais, […], préexistant à nous, nous devons, à la fois parce qu'elle est nécessaire et cachée, et comme nous le ferions pour une loi de la nature, la découvrir". J'aime cette phrase. D'abord parce qu'elle permet de dire à quel point on ne saurait attribuer à Anne Van der Linden la maternité de ces visions, même les plus dérangeantes, qu'elle a été choisie par le hasard de l'évolution, pour découvrir cette représentation là du monde. Ensuite parce qu'elle jette une continuité entre deux univers, celui de la science et celui de l'art, ici considéré comme la découverte de phénomènes pré-existants dont on ne saurait attribuer à l’artiste la paternité mais uniquement, comme le chercheur, la révélation. Anne Van Der Linden est à ce titre l’une des grandes chercheuses du siècle.